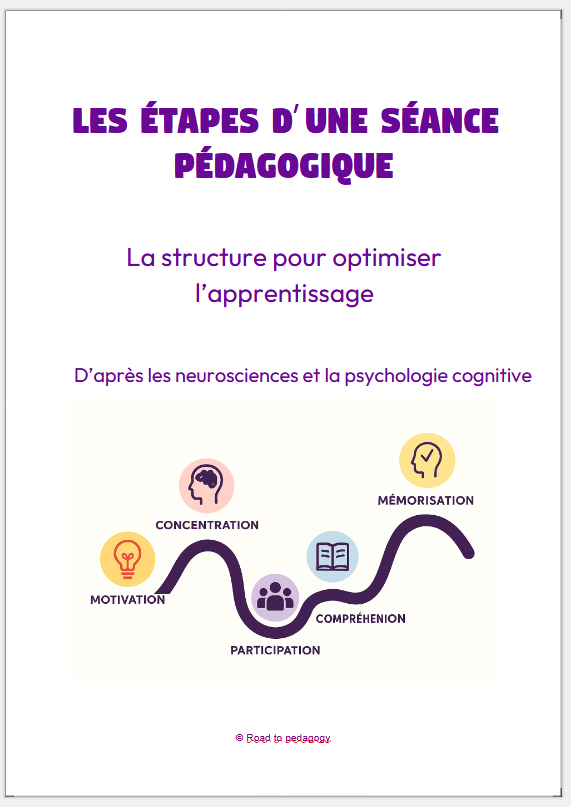Les objectifs de la forme scolaire #2 -Unification du contenu à l'échelle nationale
La première caractéristique de la forme scolaire est la mutualisation de l’enseignement au XVIe siècle, qui remplace un système de précepteurs remontant à l’Antiquité.
La mutualisation de l'enseignement a deux grands objectifs:
-spécialisation et formalisation du savoir
-unification du contenu à l'échelle nationale.
Après avoir étudié le 1e objectif dans l'article précédent, nous allons à présent détailler le 2e grand objectif qui caractérise la forme scolaire.
Le phénomène de massification est soutenu par un objectif de cohésion nationale
La mutualisation de l’enseignement permet au XVIe siècle de répondre à un objectif d’unification du contenu, de manière d’enseigner et du matériel pédagogique dans une ambition patriotique. Si la Révolution amène la démocratisation et la laïcisation des collèges, avec le noble objectif d’offrir un accès à l’éducation à tous, qui constitue encore aujourd’hui une valeur centrale de «l’école», on constate néanmoins un écart important entre le discours national se référant aux valeurs révolutionnaires, et la réalité des objectifs de la forme scolaire, qui deviennent explicites avec Jules Ferry. En effet, en instituant l’instruction obligatoire de 6 à 13 ans à la fin du XIXe siècle, et en donnant les prescriptions morales et civiques de l’école, il met l’emphase sur l’objectif patriotique de l’école plus que sur celui de la démocratisation de l’éducation. Cette dernière n’en reste pas moins une conséquence très positive qui marque un tournant historique.
C’est surtout à partir de la fin du XXe siècle que les politiques éducatives, si elles poursuivent activement cet objectif d’égalité des chances, participent à l’inverse au renforcement des inégalités. Elles sont pourtant nombreuses à aller dans le sens de la démocratisation, telles que la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans en 1959, qui ouvre le secondaire aux enfants des classes populaire; la loi Haby en 1975 qui créé le collège unique sans filières; la politique compensatoire de discrimination positive mise en place par la gauche en 1981 (par exemple avec la création des zones prioritaires); ou encore la politique des 80 % d’une génération au niveau du bac lancée par le ministre PS de l'Éducation Nationale, Jean-Pierre Chevènement, en 1985.
Pourtant, plutôt que de favoriser l’égalité des chances, ces politiques ont entraîné un phénomène de massification. Le nombre d’élèves augmente, mais la sélection s’amplifie proportionnellement. Pour illustrer ce phénomène, le vulgarisateur Franck Lepage utilise l’image d’une pyramide dont la base s’élargit. Les examens et les concours ont donc une place centrale dans la forme scolaire, et engendrent un système bureaucratique qui justifie l’institution. La mutualisation et la massification de l’enseignement apparaissent alors comme une forme nouvelle d’un système inégalitaire ancestral.
L’ouverture de l’accès à l’éducation semble plus motivée par l’ambition patriotique d’inculquer les valeurs républicaines que par celle d’offrir un enseignement émancipateur. Le système de sélection et la pédagogie inapte à former un esprit scientifique cassent la portée émancipatrice de l’école pour la réduire à un système de formatage et de contrôle des citoyens. Le rejet des apports de l’Education Nouvelle, qui apparaît au XXe siècle et démontre scientifiquement le manque d’efficience pédagogique de la forme scolaire, témoigne du statut secondaire de la construction d’un rapport au savoir dans cette conception éducative. La priorité est de former des citoyens aux valeurs républicaines. Pour Choukri Ben-Ayed (2013), cet esprit national est particulièrement révélé par les périodes de crises telles que les années 1870 marquées par Jules Ferry, ou plus récemment, les attentats de 2015 qui ont poussé le Ministère de l’Éducation Nationale à renforcer le rôle de transmission identitaire nationale de l’école.
Le contenu scolaire est unifié au prisme des valeurs républicaines
L’interdiction du port du voile à l’école en 2004 et de l’instruction en famille sans motif valable avec la loi contre le séparatisme en 2021 témoignent du rôle central attribué à l’école pour maintenir une cohésion nationale. Les religions sont désormais perçues comme des menaces de cette dernière, expliquant l’importance croissante donnée à la laïcité et la transformation de son objectif originel. Si la laïcité visait initialement à garantir la liberté de pratiquer sa religion, elle consiste désormais à restreindre la religion à la sphère privée.
Il en découle un évitement de la question morale au sein de classe. Les professeurs ont l’interdiction de partager leurs convictions personnelles, et pour devoir de transmettre les valeurs de la République. Ce sujet consubstantiel au domaine de la religion est contourné en imposant des valeurs et en les présentant comme objectivement universelles. Plutôt que de tirer la justification de cette universalité dans les textes sacrés, la société libérale les cherche dans la science. Les penseurs à l'origine du libéralisme, tels que John Locke et John Milton, prônent la sécularisation de la société, en insistant sur la séparation de l'Église et de l'État et la liberté de conscience. Cependant, ils appuient paradoxalement leur idéologie sur des fondements bibliques (valorisation de l’effort de travail, importance de la liberté individuelle). L’influence du protestantisme dans le développement du capitalisme a été étudiée par de nombreux auteurs, comme Max Weber dans son ouvrage L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme (1905). Locke, par exemple, dans ses Lettres sur la tolérance, utilise des arguments tirés de la Bible pour justifier la tolérance religieuse, tout en soutenant la nécessité de séparer les affaires religieuses des affaires civiles pour protéger la liberté individuelle (Locke, 1689). Cette contradiction révèle la tension entre le désir des penseurs libéraux de créer une société fondée sur des principes rationnels et universels et leur enracinement dans une tradition religieuse chrétienne, qui reste une source d'autorité morale pour eux.
La science ne permettant pas de répondre aux questions métaphysiques, il semble qu’une société ne puisse échapper à un système de croyance pour justifier ses normes morales. Les normes morales modernes tirent ainsi leur justification dans les principes du libéralisme, lui-même construit à partir de fondements bibliques.
Quelles sont ces valeurs républicaines, dont la transmission semble être un objectif prioritaire à celle du savoir? Une fois de plus, il existe un écart entre le discours de l’Institution et ce que nous disent les faits. Liberté, égalité et fraternité ne font pas bon ménage avec une forme scolaire fondée sur la rigidité, l’élitisme et la compétitivité. Les valeurs que cherche à transmettre la République sont plutôt dictées par une économie libérale, visant à former des futurs citoyens s’insérant dans un système capitaliste.
C'est ce que nous allons voir dans le prochain article.