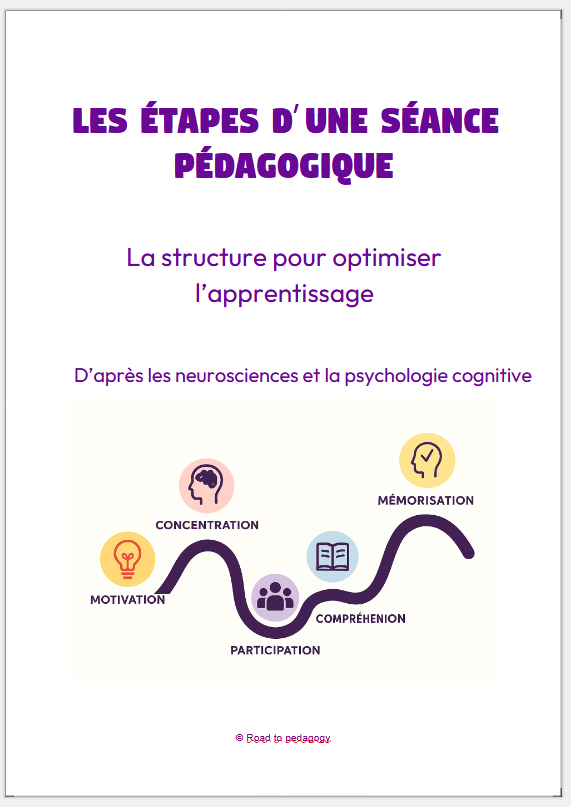La rigidité du cadre scolaire
La pédagogie transmissive est à l’origine de la salle de classe, qui permet de mobiliser l’attention des élève tournés vers le maître, et d’immobiliser le corps sur une chaise. Cette pédagogie reposant sur une décontextualisation du savoir, l’école a pris la forme d’un environnement artificiel et déshumanisant.
Le fait d’enseigner à un groupe d’élèves n’est pas nouveau, et l'éducation mutualisée a pris de nombreuses formes dans l’histoire. Elle est une conséquence logique du fait qu’il y a plus d’apprenants que d’enseignants, et ce particulièrement dans un contexte de spécialisation du savoir. Le lieu où se retrouvent l’enseignant et les élèves et les codes définissant leur relation sont infiniment variés. Ils peuvent être spontanés ou définis, rigides ou flexibles.
La forme scolaire est une forme d’éducation mutualisée particulièrement rigide: elle est définie par un lieu précis (l’école), par une temporalité précise (la journée, les trimestres, les cycles primaires et secondaires) et par des acteurs précis (les enseignants et les élèves).
Les lieux ne varient pas (à l’exception des sorties scolaires), et surtout la temporalité est extrême: la participation est totale ou inexistante. Il n’y a pas de variation possible entre la déscolarisation et la scolarisation, qui implique un investissement à plein temps (toute la journée, toute la semaine, toute l’année, de la maternelle au lycée). Les acteurs, enfin, sont eux aussi rigides, puisque les enseignants sont formés de la même manière et doivent se conformer aux mêmes attentes institutionnelles.
Nous détaillerons dans les prochains articles cette rigidité du cadre spatial, temporel et pédagogique.
La forme scolaire est ainsi plus précisément un modèle d’éducation mutualisée organisée, puisqu’elle est associée à un espace-temps, des acteurs et des règles spécifiques. Elle se confond alors avec le cadre: le fait d’associer l’apprentissage à un espace, une temporalité et des codes permet d’instaurer un cadre. Cette confusion entre le cadre et la forme scolaire peut amener à ne pas dissocier les deux concepts, alors que la notion de cadre n’est pas consubstantielle à une forme scolaire spécifique. Cette confusion comporte un autre risque: celui de réduire la notion de cadre à la manière dont elle est appliquée dans la forme scolaire actuelle, c’est-à-dire un cadre qui n’est pas ou peu envisagé dans en terme de polarité avec la notion de liberté. Or, c’est l’équilibre entre cadre et liberté qui permet de créer les conditions favorables à l’apprentissage.
Si l’école a évolué et pris en compte les apports des psychologues comme Jean Piaget notamment au niveau des curricula, l’architecture révèle encore une conception de l’élève comme suspect. La cour panoptique et aseptisée, en particulier, assure une surveillance efficace et une facilitation du maintien de l'hygiène, et révèle une école pensée pour les adultes, et non pour le développement des enfants. La réduction de l'enfant à un statut d'élève, auquel on associe suspicion et infériorité, entraîne une négation de l’hétérogénéité des apprenants, de leurs intelligences, de leurs manières d’apprendre, et de leurs rythmes.
Cette rigidité est d’autant plus problématique pour les élèves atteints de handicaps, engendrant souvent des souffrances significatives. Ce modèle éducatif standardisé, centré sur des méthodes d'enseignement uniformes et des attentes homogènes, tend à ignorer les besoins individuels des élèves, particulièrement ceux ayant des handicaps physiques, sensoriels, cognitifs ou neurodéveloppementaux.
Pour les élèves atteints de handicaps physiques, comme la paralysie cérébrale ou les troubles moteurs, les infrastructures et les programmes scolaires non adaptés peuvent limiter leur accès aux salles de classe, aux activités éducatives et à la participation pleine et entière aux cours. La rigidité de la forme scolaire empêche souvent ces élèves de bénéficier des aménagements nécessaires pour faciliter leur apprentissage et leur mobilité. Cette exclusion physique et logistique peut entraîner des sentiments de frustration, d'isolement et de marginalisation.
Les élèves avec des troubles sensoriels, comme la surdité ou la cécité, rencontrent des obstacles similaires. Les écoles qui n'adoptent pas des pratiques inclusives, telles que l'utilisation de supports visuels, auditifs ou tactiles, et qui ne forment pas adéquatement leur personnel à la langue des signes ou aux technologies d'assistance, échouent souvent à fournir un environnement d'apprentissage accessible. Cette carence en adaptation génère des lacunes éducatives importantes et des difficultés supplémentaires pour ces élèves, les privant de leurs droits à une éducation équitable et inclusive.
Les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, tels que l'autisme ou la dyslexie, sont particulièrement vulnérables dans un système scolaire rigide. Ces élèves peuvent avoir des modes d'apprentissage, des rythmes et des besoins spécifiques qui diffèrent de la norme. Le manque de flexibilité et de personnalisation dans l'enseignement, combiné à une évaluation basée sur des standards uniformes, ne prend pas en compte ces différences. Par conséquent, ces élèves peuvent être injustement perçus comme sous-performants ou indisciplinés, ce qui affecte leur estime de soi et leur motivation.
La rigidité des attentes comportementales et des normes sociales dans les écoles peut également être problématique. Les élèves avec des troubles émotionnels ou des conditions comme le TDAH peuvent éprouver des difficultés à se conformer aux règles strictes de comportement et aux routines imposées. Sans stratégies d'intervention comportementale appropriées et un environnement compréhensif, ces élèves peuvent être stigmatisés, punis ou exclus, exacerbant leurs défis et leurs souffrances.
Intéressé par ces questions, l’enseignant Vincent Faillet (2020) abandonne par exemple l’image d’un modèle standard d’élève pour adopter une conception dynamique de l’élève, qui est pour lui un être en perpétuelle évolution, avec ses rythmes propres et son imprévisibilité.
Pourtant, les exigences de différenciation pédagogique et de prise en compte des besoins éducatifs particuliers transforment la forme scolaire et, sous un aspect bénéfique et ouvert, posent de nouveaux problèmes. En effet, d’autres enseignants considèrent que l’enfant a aussi droit à ce que l’école n’ait pas une entière main mise sur sa personnalité en le considérant simplement comme un élève, les règles impersonnelles donnant paradoxalement des latitudes de réflexion et d'action. C’est ce que confirme une étude sur les représentations des élèves de l’école (Sgard Anne et Hoyaux André-Frédéric, 2006) : une « dialectique contrainte-convivialité guide également leur discours sur l’intérieur du lycée, ce que nous abordons dans notre questionnement initial comme un espace fragmenté, difficilement partagé. C’est bien au contraire ce qui ressort comme un des éléments communs aux diverses configurations : oubli des limites, effacement des murs et des grilles, au profit de marges mouvantes qui tendent à étendre le lycée en dehors de ses limites matériellement tracées. Ainsi, la rue longeant l’entrée avec le muret et les bancs où les élèves se retrouvent le matin fait partie du lycée ; dans certains entretiens on a même l’impression que la place où les cars scolaires déversent les cohortes d’élèves chaque matin, voire le car scolaire lui-même, sont également intégrés dans ce que les élèves appellent le lycée. » De même, le rythme scolaire imposé n’est pas vu comme une contrainte par les élèves, qui le complètent par une routine pour combler les moments de creux, mais comme rassurant.
Cette étude confirme le besoin de cadre des enfants, adolescents et adultes. L’excès de rigidité de la forme scolaire ne doit donc pas pousser à abolir toute forme de cadre mais invite plutôt à penser une structure plus flexible.