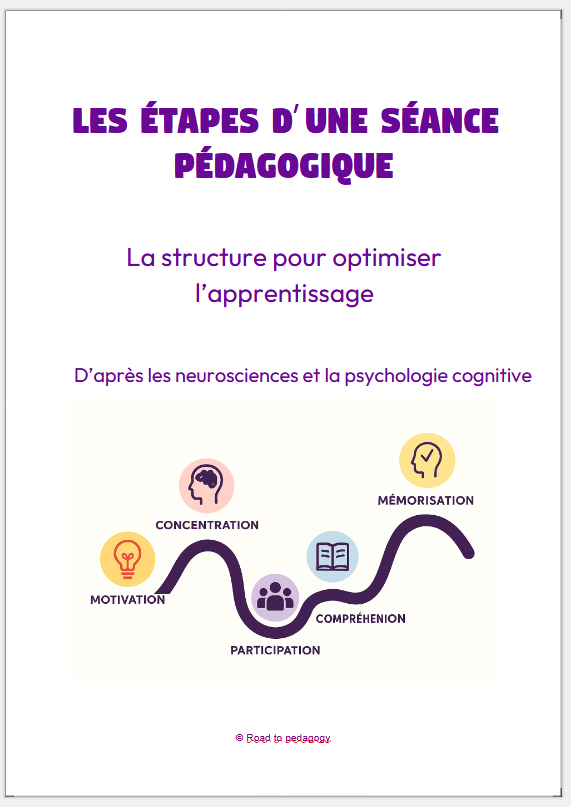La forme scolaire est structurée pour créer des inégalités
Les politiques d’égalité des chances ont eu un effet inverse, et ce parce que le réel objectif n’était pas celui de la démocratisation comme annoncé médiatiquement, mais plutôt la massification de l’éducation tout en maintenant une structure élitiste grâce à un système de sélection.
Alors que la volonté de démocratisation de l’éducation constitue encore un pilier des valeurs prônées de l’école de la République, ainsi que des droits de l’homme, il est important de réaliser que la forme scolaire est animée par un objectif économique, en tant que pierre angulaire du fonctionnement d’une société libérale.
Nous allons voir dans cet article en quoi la forme scolaire est structurellement organisée pour maintenir et accentuer les inégalités sociales, à travers une analyse aux échelles macro, micro et mésoscopique.
Les inégalités à l'échelle du système scolaire
À l’échelle macroscopique, Bourdieu et Passeron (1970) expliquent les inégalités à travers les fonctions sociales de l’école.
La fonction de reproduction
La première est la fonction de reproduction: pour Bourdieu, le capital économique, culturel, social et symbolique se transmet de génération en génération. Selon lui, la «langue est la part la plus insaisissable et la plus agissante de l'héritage culturel ». En effet, en tant que syntaxe, elle procure un système de postures mentales transposables, elles-mêmes solidaires des valeurs qui dominent toute l'expérience. De plus, la langue universitaire est très inégalement éloignée de la langue effectivement parlée par les différentes classes sociales.
La fonction de légitimation
La deuxième est la fonction de légitimation, c’est-à-dire d’individualisation de la responsabilité de sa trajectoire, alors même qu’elle est loin de ne dépendre que du mérite. C’est en cela que le discours d’égalité des chances rend légitime l’inégalité de la société.
La fonction de translation des chances
La troisième fonction est la translation de la structure des chances : il y a une démocratisation, mais la sélection augmente.
Les inégalités à l'échelle de la classe
L’analyse à l’échelle microscopique permet de comprendre plus concrètement comment ces fonctions sociales de l’école sont appliquées à l’échelle de la classe.
Le malentendu pédagogique
Pour Pierre Bourdieu, la première contribution de la forme scolaire aux inégalités sociales est le phénomène de malentendu pédagogique, c’est-à-dire le présupposé que la langue d’enseignement est maîtrisée par les élèves. Or, celle-ci repose sur des prérequis constituant le code implicite, qui comporte les savoirs et connaissances culturelles, le rapport à la culture, les techniques d’apprentissage, la mise en pratique des techniques.
En effet, les familles aisées ont généralement plus de moyens pour offrir des activités culturelles (visites de musées, voyages, etc.) à leurs enfants, renforçant ainsi leur capital culturel. De plus, l’habitus des élèves favorisés, c’est-à-dire les dispositions durables acquises par un individu au sein de son milieu social (par exemple, la manière de parler, de se comporter), correspond aux attentes de l’institution scolaire. Les enfants de classes favorisées maîtrisent souvent des formes de langage et de communication qui sont valorisées à l'école, en particulier la culture de l’écrit, sur laquelle repose la forme scolaire.
Ces prérequis sont d’ailleurs accentués par le fait que cette dernière se base sur du papier et des représentations plutôt que des manipulations. L’écriture et l’abstraction constituent une barrière au savoir, tandis que l’oralité et l’expérimentation permettent d’apprendre sans être freiné par les difficultés de lecture. Par ailleurs, les attitudes valorisées par l'école, telles que la discipline, la curiosité intellectuelle ou la confiance en soi, sont plus souvent encouragées et développées dans les familles favorisées. Ces prérequis sont essentiels pour s’adapter aux codes scolaires, en transformant ce que l'on reçoit oralement à l'écrit, en verbalisant des expériences, en comprenant les questions rhétoriques de l’enseignant, en interprétant les changements de ton...
Privation et connivence
Ainsi, l’enseignement de savoirs repose sur un code qui n’est par définition lui-même pas enseigné et doit donc être déchiffré maladroitement par les élèves. C’est ce phénomène de privation qui participe à la fonction sociale de reproduction, car l’enseignant ne donne pas aux élèves tout ce qui est nécessaire pour comprendre en faisant reposer son cours sur des prérequis.
La privation, imbriquée avec la connivence entre l'institution et ceux qui partagent ses attentes culturelles, contribue à la reproduction des inégalités sociales. En effet, ce sont justement les prérequis que l’école valorise, alors même que ces compétences ne sont pas toujours explicitement enseignées mais sont plutôt acquises de manière tacite dans des contextes familiaux et sociaux spécifiques. En d'autres termes, la fonction de connivence signifie que les institutions sociales, en particulier l'école, favorisent ceux qui possèdent déjà les codes culturels et sociaux implicites nécessaires à leur réussite. C’est ainsi que l’école fabrique des inégalités de façon passive en n’agissant pas contre les écarts familiaux et en étant « indifférente aux différences ».
Dénivellement des exigences
Ensuite, l’école fabrique de manière active des inégalités en enseignant des choses différentes selon le profil des élèves, bien que la différence des objectifs soit souvent inconsciente. C’est le phénomène de dénivellement des exigences, qui consiste à baisser le niveau selon le public. Une de ses formes consiste à permettre à l’élève d’arriver au résultat sans passer par le savoir, et de faire croire à l’élève que c’est lui qui a découvert la réponse. Cela constitue une rupture du contrat didactique : l'enseignant ne transmet plus un savoir mais flatte l'élève en ignorant ses erreurs.
L'assignation
Enfin, la fonction de légitimation de l’école est permise par le phénomène d’assignation, qui renvoie l’élève à une place assignée et constitue une violence symbolique. Il s’agit d’une fabrication idéologique des inégalités : on inculque aux élèves une façon de se percevoir qui les limite dans leurs capacités.
Les inégalités à l'échelle du dispositif pédagogique
Enfin, l’échelle mésoscopique, en faisant le lien entre les échelles macro et micro, permet de comprendre ce qu’il y a de commun mais aussi les nuances entre les manières de faire des enseignants. Il s’agit donc d’un analyse du dispositif pédagogique, qui se définit selon Foucault (1975) comme un ensemble d'agencement matériel qui constitue un espace de contraintes et de possibilités pour les acteurs et qui guide ce qu'ils peuvent faire dans ce contexte. Nous allons donc étudier en quoi le dispositif pédagogique contribue aux inégalités sociales.
L'organisation temporelle
D’abord, l’organisation temporelle du dispositif est inégalitaire, en ce que les élèves ne sont pas mobilisés de la même façon au cours des différentes phases du cours. Lors de la première phase de mise en situation, il s’agit d’enrôler les élèves dans la tâches, et les premières interventions concernent souvent des aspects extérieurs aux apprentissage (mise en place, concentration) et s’adressent plus à des élèves en difficulté. La deuxième phase de formalisation du savoir (à travers la correction) est aussi caractérisée par un dénivellement des exigences: l’enseignant a tendance à interroger les élèves en difficulté quand les questions sont faciles car il sait qu'ils ne lèveront pas la main lors des questions plus dures. Ces derniers sont alors spectateurs de la verbalisation des bonnes réponses, et l’enseignant fait comme si tous les élèves avaient construit le savoir.
L'organisation spatiale
Ensuite, l’organisation spatiale peut elle aussi participer au renforcement des inégalités, selon la disposition des tables (en rangées, en U, en îlots...). L’organisation en îlots favorise particulièrement le dénivellement des exigences en ce que des élèves de niveaux différents sont souvent mélangés dans les groupe, poussant les moins bons à rester passifs, tandis que les meilleurs font les sauts cognitifs. Le dénivellement se fait alors tout seul dans le groupe, sans l’intervention de l’enseignant.
Les supports pédagogiques
Enfin, les supports pédagogiques utilisés contribuent aussi à la reproduction sociale à travers les phénomènes de privation et de connivence, en ce que les modes de raisonnement qu’ils visent sont associés à des systèmes sémiotiques (techniques de l’écrit): il s’agit de la littératie (Jack Goody, 1977). Bien que les formes de littératie des supports aient beaucoup évolué, elles reposent toujours sur des prérequis.
Conclusion
Ainsi, la forme scolaire est structurée pour renforcer les inégalités sociales en ce qu’elle repose sur des codes connivents avec ceux les populations privilégiées, et que ces codes n’ont pas pour objectifs d’être explicités. Ils sont plutôt utilisés comme outils de sélection, la réussite étant plus dépendante du statut social que du mérite. En effet, le phénomène de privation révèle que ces prérequis doivent rester implicites. Les phénomènes de dénivellement des exigences et d’assignation révèlent eux aussi que l’écart de niveau doit être maintenu. L’ensemble des caractéristiques de la forme scolaire (sa structuration du savoir, son organisation spatiale et temporelle, les formes de littératie de ses supports pédagogiques, les codes de la relation entre le maître et les élèves) participent à la réalisation de cette finalité qu’est le renforcement des inégalités sociales.