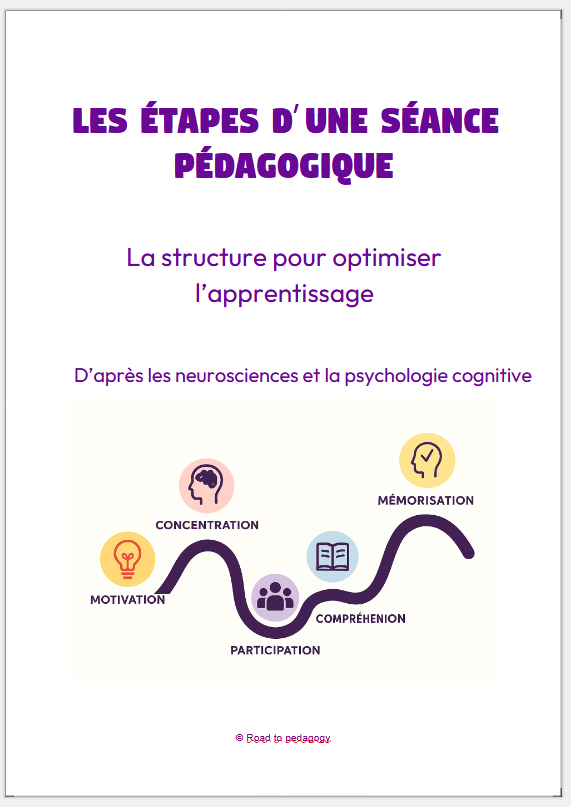La décontextualisation du savoir : un frein invisible à l’apprentissage
La formation d’un concept et plus naturelle que l’acquisition d’un concept
Ivan Illich (1971) explique qu’en donnant un statut éducatif aux choses, l’école leur fait perdre leur vertu vivante. Le modèle de formalisation de la forme scolaire, consistant à décontextualiser le savoir en le coupant de l’expérience vécue, est remis en question par les recherches psychocognitives, qui étudient la manière dont fonctionne le processus d’abstraction.
Elles révèlent que le cerveau est naturellement câblé pour chercher des similitudes entre les éléments qu’il perçoit et créer des concepts à partir des attributs communs. C’est pourquoi le fait de présenter non pas un mais une multitude d’exemples, et de les faire précéder à la définition, est une manière plus efficiente de favoriser la conceptualisation. Elle permet en outre à l’apprenant de former le concept plutôt que d’essayer de l’intégrer, ce qui assure une compréhension plus profonde et durable. Il est alors capable d’exprimer lui-même la définition du concept, car il a perçu les attributs communs essentiels à une série d’exemples stratégiquement choisis par l’enseignant.
Le modèle de formalisation actuel consiste à l’inverse à commencer par énoncer la définition, puis à présenter un exemple. Le fait de ne pas diversifier les exemples va à l’inverse du fonctionnement du cerveau, qui repère les attributs essentiels à travers une diversité d’éléments. La chercheuse Britt-Mari Barth donne un exemple: si l’on définit le concept de cercle, et que l’exemple présente un cercle bleu et petit, l’élève risque d’associer les attributs non essentiels (ici bleu et petit) au concept (de cercle). Mais en diversifiant les exemples (des cercles de taille, couleur, matière différentes), l’élève saura naturellement repérer les attributs essentiels, c’est-à-dire partagés par tous les exemples, et tout naturellement construire la définition du concept.
L’apprentissage dans tout son potentiel exige la prise en compte de la cognition étendue
Ainsi, il est possible de formaliser le savoir de manière à suivre le processus naturel d’abstraction tout en restant dans une salle de classe. Néanmoins, la logique du processus d’abstraction est adaptée pour apprendre à partir d’expériences vécues. D’autres études nous montrent justement que l’implication des sens est une manière bien plus efficiente d’apprendre. Surtout, cela donne du sens à l’apprentissage. La forme scolaire repose exclusivement sur la capacité d’abstraction, au détriment des émotions, des sensations et des valeurs. L’existence du corps est déniée, réduisant l’élève à son cerveau, comme le révèlent les règles scolaires d'écoute et d'immobilité.
Pourtant, les études récentes démontrent l’importance de prendre en compte la cognition étendue. Ce concept, développé par le neurobiologiste et neuro phénoménologue Francisco Varela (1994), désigne la cognition dans son ensemble, comprenant les fonctions cognitives (intellectuelles), perceptives, affectives, conatives et réflexives:
Le plan perceptif
Désigne le processus de sélection par le cerveau d’informations extéroceptives et intéroceptives perçues par les sens.
Le plan affectif
Renvoie à la façon dont le cerveau construit de manière spontanée un sens spécifique (émotion) à partir d’une sensation vécue ou imaginée afin de s’adapter à une situation perçue.
Le plan conatif
Désigne la manière dont les expériences passées (biographie, mémoire) et les valeurs influencent l’intention, la motivation et la volonté d’action.
Le plan réflexif
Renvoie à la façon dont les perceptions, les émotions et les intentions influencent les processus mentaux plus ou moins conscients pouvant amener à une action.
Une pédagogie holistique prend en compte l’ensemble des dimensions de la cognition étendue, reliant le corps et le cerveau. Elle implique les émotions et les sens tout en donnant du sens. Elle permet ainsi de susciter une motivation intrinsèque, et de développer un rapport subjectif à l’apprentissage qui participe à sa construction identitaire.
À l’inverse, la pédagogie transmissive repose exclusivement sur la dimension réflexive, niant la dimension corporelle. Elle vise à l’acquisition de connaissances plutôt qu’à la construction d’un rapport au savoir qui fait sens pour soi. Elle repose donc exclusivement sur une motivation extrinsèque ( reconnaissance sociale via le système de notes et de diplômes). L’élève ne développe alors pas de rapport subjectif au savoir, et ne parvient donc pas à l’acquérir de manière solide, et encore moins à le remobiliser dans d’autres contextes.
De plus, le cloisonnement des disciplines, à l’inverse de la transdisciplinarité, ne favorise pas la décontextualisation du savoir. La spécialisation limite la mise en lien des différentes sciences.
Conclusion
Ainsi, la pédagogie transmissive de la forme scolaire repose sur une formalisation du savoir décontextualisée de l’expérience vécue, allant à l’inverse du fonctionnement neuro-cognitif. En ne prenant pas en compte la cognition étendue, elle réduit l’apprentissage à une acquisition superficielle et peu durable de connaissances, dénuée de sens.
D'après les études sur le fonctionnement du processus d’abstraction, il semblerait que la décontextualisation du savoir devrait passer non pas par la privation d’expérience vécue, mais plutôt par la diversification d’expériences vécues, et la mise en lien de ces dernières.