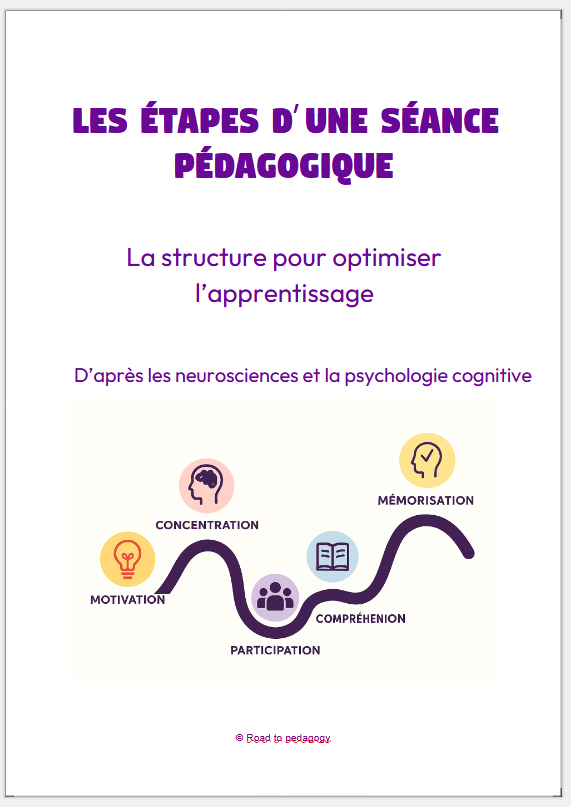En quoi l'institution scolaire est-elle contrepoductive?
L’Institution est intrinsèquement déshumanisante
La nationalisation de l’école implique l’institutionnalisation du système scolaire. Or, le concept même d’Institution contient des limites. Nous allons voir que les critiques avancées par plusieurs auteurs venant du milieu psychanalytique sont transposables à l’Institution scolaire.
Erving Goffman (1968) développe la notion d’ « institution totale » pour désigner le fait que la totalité de notre vie est prise dans des institutions, de notre naissance à notre mort. Cela conduit à une déshumanisation, un étiquetage, une réduction, ainsi qu’à l’impression que la machine structurelle englobante qu’est l’institution nous domine (Luc Boltanski et Eve Chiapello, 1999) et nous aliène (Max Weber), qu’elle nous enferme dans une cage d’acier (Michaël Löwy), qu’elle est étrange, distante, et que ses fonctionnements bureaucratiques nous empêchent d’avoir une prise sur elle.
Selon Ivan Illich (1971), l’aliénation commence à l’école, qui sépare l’éducation de la réalité et le travail de la créativité. Elle impose aux enfants d’être des enfants ( c’est-à-dire contrairement aux adultes de ne pas pouvoir travailler mais de devoir aller à l’école) selon un principe de protection de l’enfance alors que les enfants détestent faire les enfants. Il rejoint ainsi Maria Montessori, pour qui les enfants préfèrent faire pour de vrai plutôt que faire semblant.
Les institutions (scolaire, hospitalière, pénitencière etc) sont de plus critiquées pour leur inefficacité, puisqu’elles vont même selon Russel Barton (1974) jusqu’à créer des pathologies au lieu de les guérir. Il parle ainsi de « névrose institutionnelle » pour caractériser la dimension subjective de l’institution, ses désirs inconscients et ses stéréotypes anti-thérapeutiques. Les institutions produisent l’inverse de leur finalité de par leurs contradictions : par exemple, si elles tendent à une fluidité des échanges, elles les bloquent en fait par une multitude d’interruptions et de frontières. Aussi, Jean-Paul Sartre (1960) développe l’idée de sérialité pour désigner le caractère répétitif et vide d’un style d’existence relevant d’un fonctionnement de groupe « practico-inerte ».
C’est pourquoi Félix Guattari (1974) prône la transversalité et la créativité. Face aux blocages institutionnels, David Wengrow et David Graeber (2021) incitent à s’inspirer de la diversité et de la flexibilité des formes de pouvoir dans l’histoire. On cherche à identifier les normes instituées, notamment en confrontant une population à un comportement inhabituel selon l’ethnométhodologie, et on les remet en question.
La critique des institutions prend plusieurs formes, dont René Lourau (1970) fait l’état en décrivant les modes d’actions institutionnel, anti-institutionnel (détruire l’institution), non-institutionnel (alternative), contre-institutionnel (institutions conscientes de leur précarité et de leur aspect contestataire). Ils sont animés par la volonté de réparer les institutions, car pour le Dr Jeangirard, « soigner l’institution, c’est soigner le psychotique ».
Ainsi, pour Jean Oury (1985), il s’agit de créer en permanence des institutions (mode d’action institutionnel). Pour Franco Basaglia (1970), il s’agit de détruire l’asile pour d’autres formes, de détruire l’établissement mais pas l’institution qui doit prendre plusieurs formes (désinstitutionnalisation), d’accepter de vivre avec les contradictions et de refuser le choix binaire entre la gestion démocratique et la révolution (c’est-à-dire un questionnement radical sur la démocratie). Pour Felix Guattari (1989), il s’agit de passer de groupes-objets (passifs, qui reçoivent la loi de l’extérieur), à des groupes-sujets (autonomes).
Plus récemment, les artistes socialement et corporellement engagés de l’association AIME entrent dans des EHPAD afin de polliniser, d’ensemencer des territoires qui se veulent séparés du monde en réintroduisant un entremêlement avec l’extérieur et en laissant des traces, pour dénaturaliser dans nos imaginaires communs ce que sont devenus ces espaces institutionnels.
Dans ces tentatives pour sauver l’institution, on voit le lien entre le matériel et le symbolique : soigner l’institution, c’est repenser le bâtiment et son fonctionnement.
Les institutions alternatives se heurtent cependant à une double conflictualité. D’abord interne, car l’autogestion n’est pas naturelle, alors que la division du travail est ancrée. Ensuite externe, c’est-à-dire le refus des institutions étatiques. Celles-ci, en cherchant à transmettre des normes, sont en effet conservatrices, et résistent à notre volonté de transformation. Si elles sont relatives, car critiquables, elles ont aussi une dimension évidente, en ce qu’elles semblent naturelles, qui complexifie leur remise en question.
L’Etat met d’ailleurs en place des moyens pour faire adhérer les citoyens à des normes élaborées par des mouvements sociaux et devenues absurdes. François Héran (1987) parle d’ « institution démotivée » pour caractériser les automatismes chez les acteurs, qui peut conduire à une crise de légitimité et de fonctionnalité. À l’inverse, la convergence paradoxale entre la remise en question de l’institution psychiatrique et la volonté de l’ Etat de baisser les dépenses du service public a aboutit à l’abandon des malades.
Enfin, l’absence de prise en compte des spécificités du terrain peut conduire à l’échec de tentatives d’institutions alternatives, comme celle en Afrique portée par Franz Fanon (1953) a échoué.
Pour répondre à ces difficultés, la lutte contres les automatismes par les réflexions collectives et les prises de recul semblent nécessaire. C’est ce que semble apporter la forme partenariale à laquelle nous dédierons un article.
Les dimensions culturelle et historique de l’organisation politique française constituent des verrous à l’innovation
À ces limites intrinsèques au concept d’Institution, viennent s’ajouter des spécificités françaises qui renforcent le manque d’efficacité des services publics.
Nada Abdelkader Benmansour (2011) constate un manque d’écoute de la part du gouvernement, résistance culturelle française. En effet, l’administration française cherche plus l’expertise que la satisfaction des citoyens, allant ainsi à l’inverse de la norme qualitative visant à répondre à un besoin, et expliquant l’absence de recueillement des attentes des citoyens.
Nada Abdelkader Benmansour affirme que le débat sur le service public ne peut pas être circonscrit à des enjeux économiques ou techniques mais qu’au-delà de ces enjeux, il renvoie à des considérations relatives aux modes d’organisation, à une culture politique et à toute une histoire du secteur propre à chaque pays.
Elle analyse ainsi les spécificités françaises, en rappelant d’abord la forte tradition administrative du pays, contrairement aux pays anglo-saxons qui semblent plus favorables aux idées de marché ou à des pays comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne ou la Belgique dont le pouvoir exécutif est moins centralisé.
Elle constate que ces diverses pratiques conduisent à des résultats très contrastés en termes de qualité des services publics : « l’expérience britannique est devenue emblématique de par sa réussite alors qu’ailleurs - en France par exemple -, les vagues successives de modernisation ne donnent toujours pas de résultats positifs tangibles. » La France est ainsi caractérisée par le retard qu’elle a pris sur les autres pays de l’OCDE en matière de qualité des services publics.
Nada Abdelkader Benmansour cherche à l’expliquer en étudiant la place centrale du service public dans les représentations collectives des français. « Ils nourrissent à son égard des attentes fortes, voulant une prestation de qualité mais qui soit fournie dans le respect des principes de continuité et d’égalité. Pareille exigence s’enracine dans l’idée que les services publics sont un fondement de la cohésion de la société. Cette dimension mythique explique, par voie de conséquence, que la notion de service public constitue en France une question sensible. »
La cohérence entre ces valeurs républicaines et les services publics exige de ces derniers qu’il soient disponibles en tous points du territoire national et au même prix pour tout le monde. Elle fait aussi primer un intérêt général - ou un bien commun - supérieur à la somme des attentes individuelles.
Enfin, la France définit la qualité des services publics selon la qualité intrinsèque des produits et le savoir-faire des agents. Elle ne cherche donc pas à recueillir les attentes des usagers et à mesurer leur satisfaction. La définition de qualité comme « l’ensemble des propriétés et caractéristiques d’un produit ou service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins exprimés […] » selon la norme ISO 8402 est donc à l’origine d’un choc culturel pour la France.
L’enjeu pour l’administration française selon Nada Abdelkader Benmansour est ainsi de concilier le management de la qualité – qui suppose de placer l’usager-citoyen au centre de l’action – et la conception spécifique française du service public (régie par le principe fondamental d’égalité et de liberté d’accès) ; ce qui implique des changements systémiques dans la pratique de la gestion tel que la réorientation des objectifs organisationnels (Pollitt Ch., 2009), en passant d’une logique de moyen à une logique de résultats.
C’est dans cet « esprit français » que s’ancre le rapport à l’éducation et au territoire. Choukri Ben-Ayed (2013) explique brièvement la spécificité de celui-ci selon une approche maximaliste, inspirée d’Emile Durkheim, consistant à prendre en compte la multitude de facteurs influençant le système éducatif (organisation politique et histoire du pays). L’esprit national serait à la politique ce que l’épistémé est à la science pour Michel Foucault : « un soubassement archéologique du savoir scientifique d’une époque ». On prend conscience de ces derniers dans les périodes de crises et de perturbations profondes.